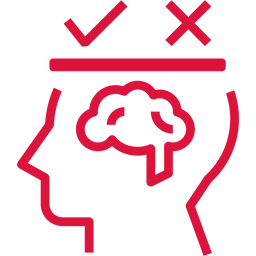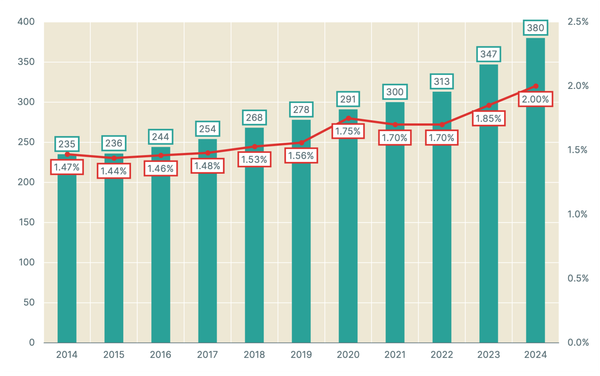#7 · Guide pratique pour (bien) utiliser les incitations
Ou comment mieux identifier quand vérifier, et quand ne pas vérifier, un argument dans un débat

Intégrer le concept d’incitations dans la boîte à outils sceptique peut permettre aux sceptiques de mieux décider quand vérifier ou ne pas vérifier un argument dans un débat. Mais, concrètement, comment utiliser le concept d’incitation ? Cet article est un guide pratique qui répond à cette question.
Si vous pensez que les incitations sont un concept utile aux sceptiques et qu’il mériterait d'être davantage connu, n’hésitez pas à largement diffuser ce guide dans vos réseaux sceptiques ! Merci 🙂
En bref
Dans la mesure où cet article est un guide pratique plutôt qu’un article classique, il n’y a exceptionnellement pas de véritable section En bref. En réalité, ce guide pratique est une sorte de section En bref géante de la série d’articles sur les incitations !
Par ailleurs, contrairement aux articles habituels, il est possible que je fasse évoluer son contenu. N’hésitez pas à venir le relire de temps en temps.
À quoi servent les incitations aux sceptiques
Avant de montrer comment utiliser les incitations, je veux d’abord expliquer à quoi elles peuvent servir aux sceptiques.
D’après moi, le concept d’incitation permet de mieux identifier le degré de confiance à accorder à un argument, et ainsi mieux décider s’il faut le vérifier ou non. Dit autrement, le concept d’incitations permet de répondre à la question suivante : puis-je faire confiance à un argument qui vient d’être utilisé dans un débat, ou faut-il que je le vérifie ?
Pour avoir une argumentation détaillée de l’intérêt du concept pour les sceptiques, vous pouvez vous référer à cet article :
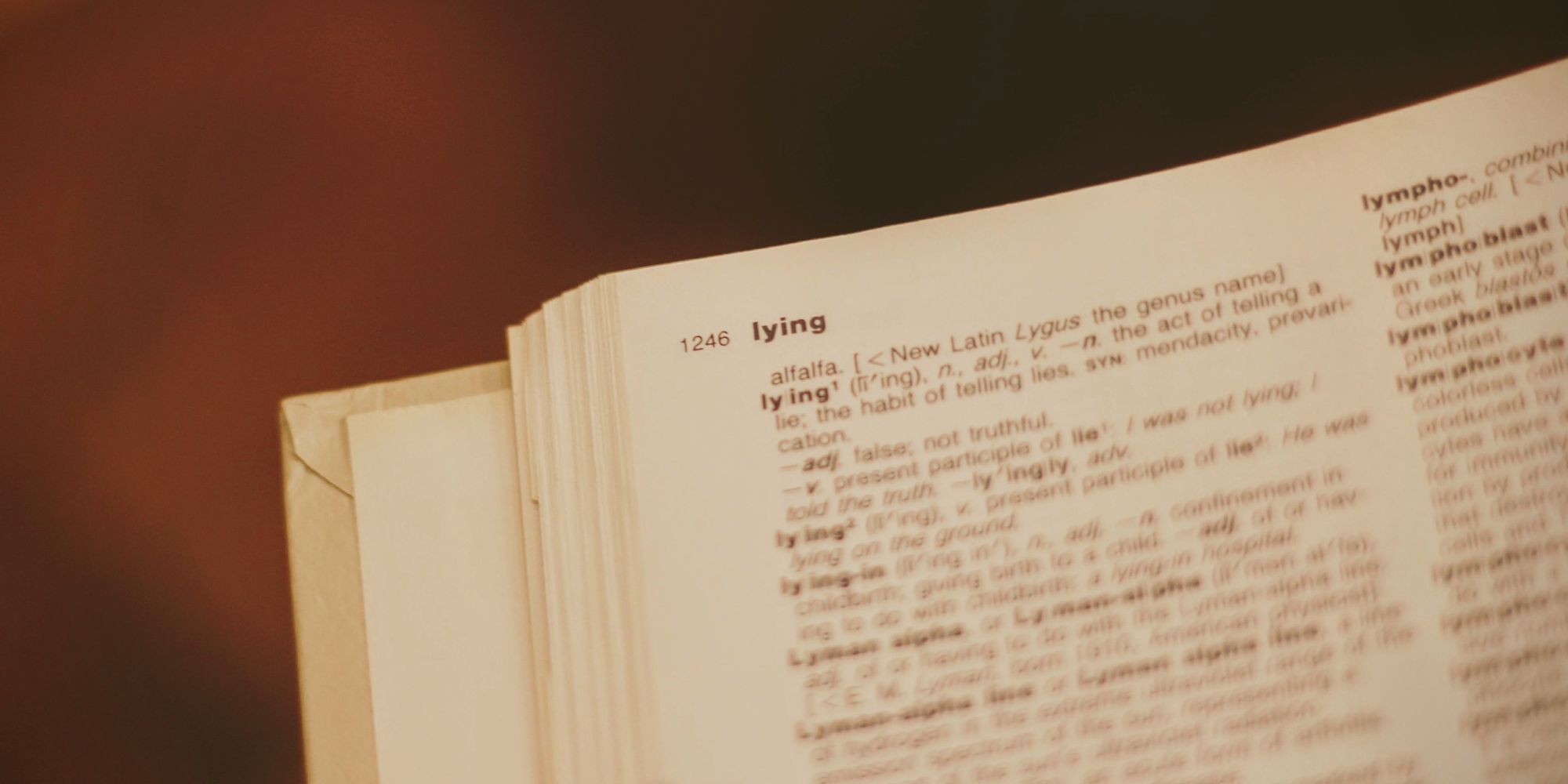
Qu’est-ce qu’une incitation ?
Une incitation est quelque chose qui nous encourage, dans une situation où nous avons à faire un choix, à choisir une certaine alternative plutôt qu’une autre.
Voici quelques exemples :
- le suspect coupable d’un meurtre (qui a bien tué la personne) a une incitation à mentir aux policiers – pour ne pas finir en prison, pour protéger sa réputation et son image
- le suspect innocent d’un meurtre (qui n’a pas tué la personne) a une incitation à dire la vérité aux policiers – pour ne pas finir en prison, pour protéger sa réputation et son image, parce qu’il trouve important que la vérité triomphe
- dans une rencontre amoureuse, on a une incitation à se présenter sous un angle plus favorable qu’on ne l’est en réalité – pour augmenter nos chances de plaire à la personne que l’on rencontre
- une entreprise dont le produit se vend très bien a une incitation à continuer à le produire et à l’améliorer – pour augmenter son chiffre d’affaires
- une entreprise en difficulté a une incitation à demander des aides à l’État – pour ne pas faire faillite, pour éviter de se lancer dans un effort important de restructuration en profondeur
- un bonimenteur qui perçoit des revenus grâce à des contenus complotistes, de fausses médecines, etc. a une incitation à continuer à produire ces contenus – pour continuer à percevoir ces revenus
Ces exemples sont tirés de l’article ci-dessous. Pour avoir une exploration détaillée de ce que sont les incitations, vous pouvez vous y référer :
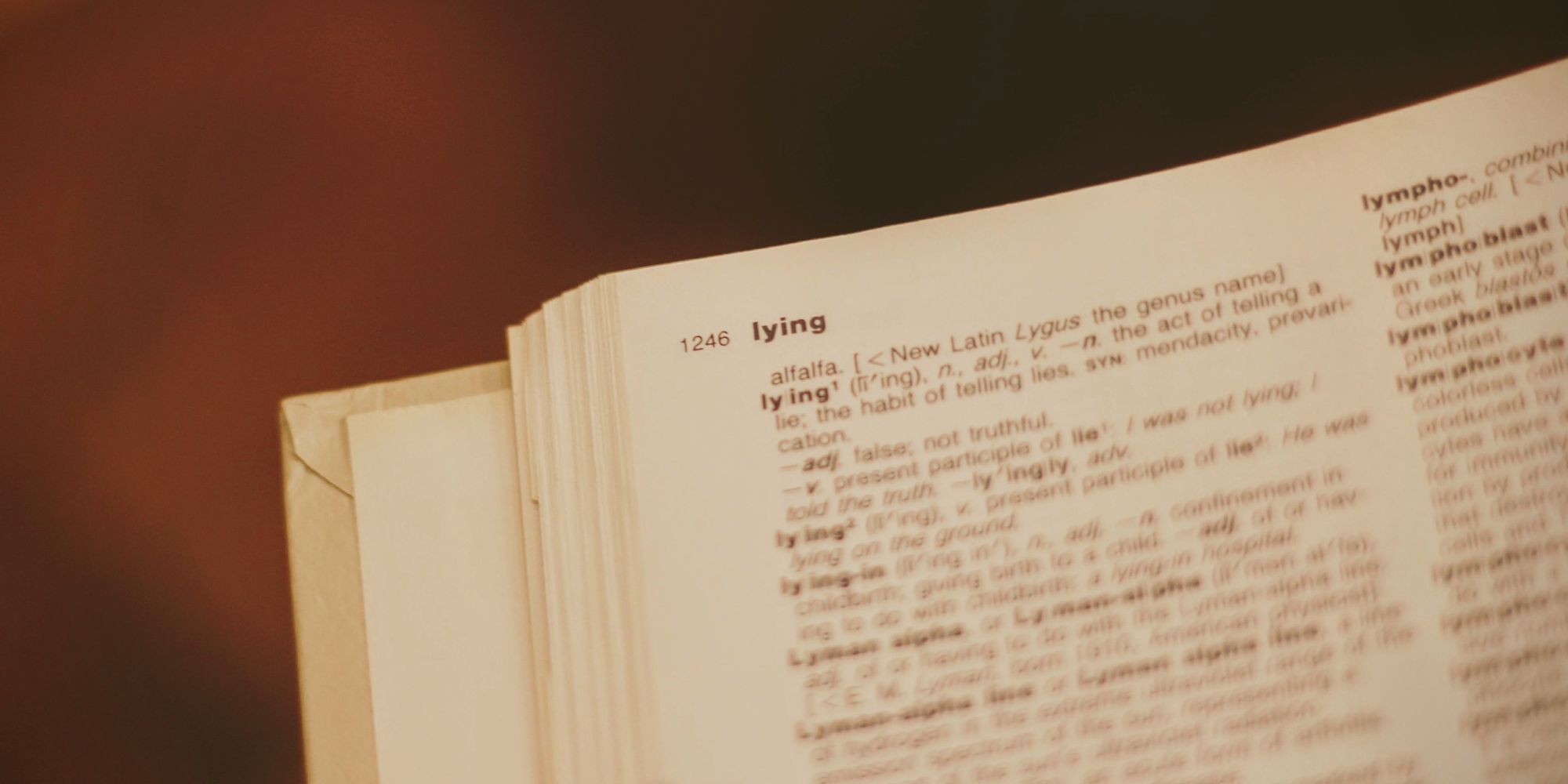
Les incitations en bref
J’ai déjà longuement abordé ce que sont les incitations dans de précédents articles. Je vais me contenter de rappeler les principaux messages – et je vous renvoie vers ces articles si vous souhaitez approfondir :
- les incitations concernent aussi bien des situations où le gain à attendre du choix est monétaire, comme non-monétaire (obtenir du prestige, appartenir à un groupe, se différencier d’un groupe, avoir une bonne image, etc.) ⤵️

- les incitations concernent aussi bien des situations où la personne est mue par égoïsme (elle fait son choix en ne considérant que son propre bien-être) comme par altruisme (elle fait son choix en considérant le bien-être d’autres personnes) ⤵️

Le concept d’incitation vient de la science économique, qui est une discipline puissante mais qui est souvent présentée de manière caricaturale dans les médias.
- La science économique est avant tout une science du choix ⤵️
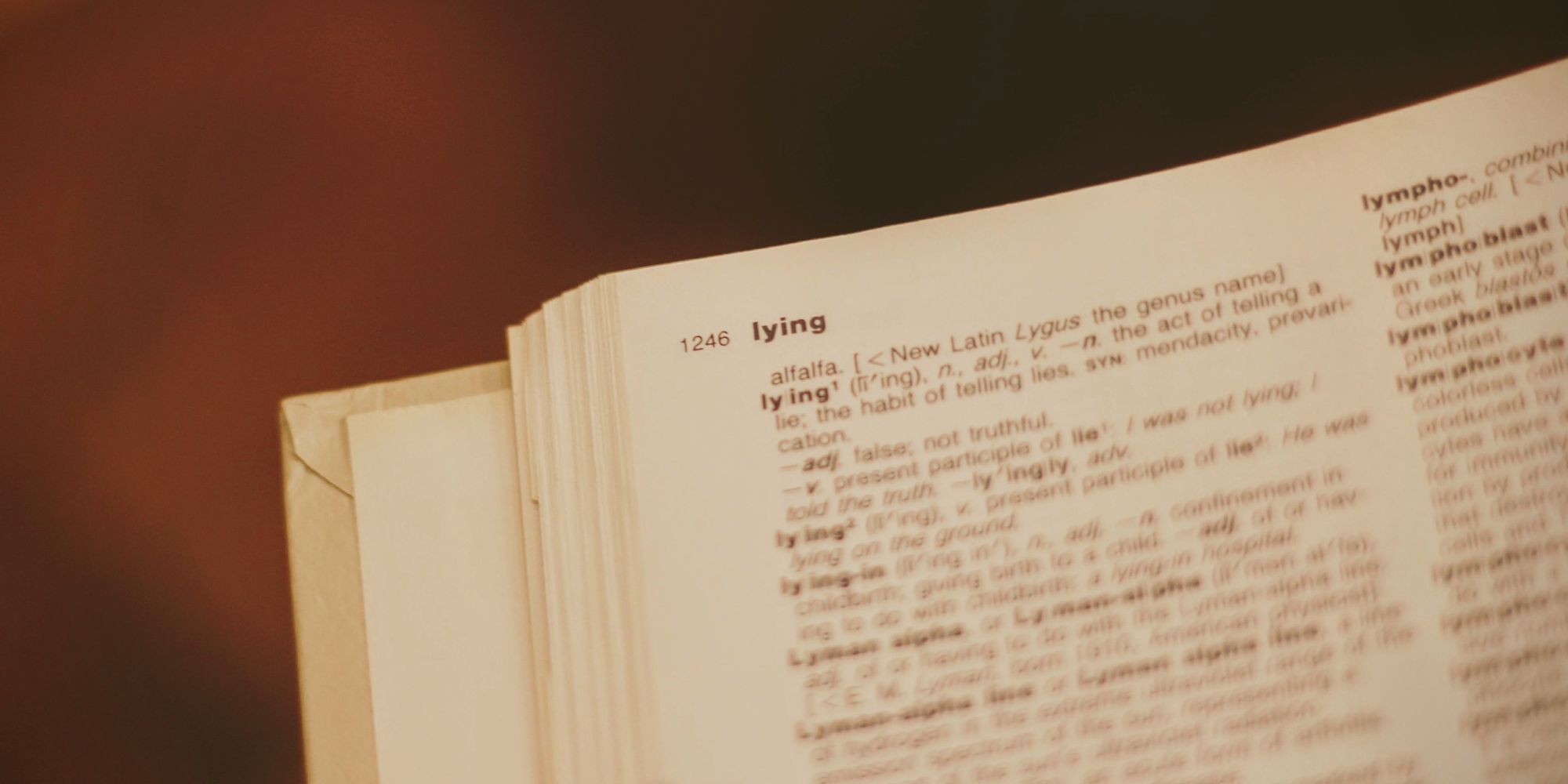
- La science économique est parfois considérée comme une “science de l’argent”, elle est en réalité bien plus que ça ⤵️

Ce que ne sont pas les incitations
S’il y avait une chose à retenir sur ce que ne sont pas les incitations, c’est la suivante : les incitations ne permettent pas de dire si un argument est vrai ou faux. Il faut, pour vérifier la véracité d’un argument, utiliser les méthodes habituelles telles que le débunk, le recours à des spécialistes ou encore la documentation.
En plus de ne pas permettre de dire si un argument est vrai ou faux, il y a de nombreuses autres choses que ne sont pas les incitations. En voici une petite liste (non-exhaustive) :
- les incitations sont un concept probabiliste et non pas déterministe : ça n’est pas parce que quelqu’un a une incitation à agir d’une certaine façon, que cette personne va nécessairement agir de cette façon
- les incitations ne sont pas un concept psychologique. Elles ne décrivent pas les mécanismes mentaux de nos prises de décision. On peut par exemple modéliser des incitations pour les plantes, qui n’ont pas de psychologie.
- les incitations décrivent avant tout des comportements individuels. Dans une même situation, elles peuvent varier d’une personne à l’autre.
- néanmoins, les sciences humaines et sociales s’intéressent d’abord aux comportements collectifs – y compris lorsqu’elles utilisent des concepts qui décrivent les comportements individuels comme le concept d’incitation. Ce qui intéresse l’économiste est généralement l’incitation “moyenne”.
- les incitations sont d’abord conçues pour étudier des choix “libres”, c’est-à-dire des choix qui ne sont pas faits sous la menace (comme celle de perdre la vie ou de se faire sérieusement blesser)
- le concept d’incitation est positif, c’est-à-dire descriptif – il dit ce qui est. Il n’est pas normatif, c’est-à-dire qu’il n’est pas une prise de position sur ce qui devrait ou pourrait être.
- les économistes francophones utilisent le terme “incitation”. Des vulgarisateurs francophones parlent d’incentives. Je n’ai jamais compris pourquoi ils n’utilisent pas le terme francophone. Dans une logique de cohérence avec la littérature scientifique, il me semble important d’utiliser le terme francophone.
Pour approfondir ce que ne sont pas les incitations, vous pouvez vous référer à cet article :

Comment, concrètement, utiliser le concept
Maintenant que toutes ces précisions ont été faites, comment concrètement faire pour identifier les incitations des parties prenantes d’un débat – et ainsi décider s’il faut vérifier ou non leurs différents arguments ?
Il faut bien avoir en tête qu’il n’y a pas de méthode miracle – pas à ma connaissance en tout cas. Il faut donc exercer son jugement et son esprit critique.
Les incitations étant attachées aux individus, la question à se poser est du type “quelle est l’incitation de l’individu X à faire l’action Y” ?
De manière générale, il est possible d’identifier les incitations en se posant des questions comme :
- est-ce que l’individu X a intérêt à faire l’action Y ?
- où sont les intérêts de l’individu X ?
- quels gains auraient à tirer l’individu X à faire l’action Y ?
- si l’individu X agit de la manière dont il.elle agit, quels gains pourraient le.la pousser à agir de la sorte ?
Néanmoins, pour les sceptiques, ce qui importe ce sont les questions à se poser pour identifier les incitations des parties prenantes d’un débat. Les voici :
- est-ce que l’individu X a intérêt à utiliser l’argument Y ?
- où sont les intérêts de l’individu X ?
- quels gains auraient à tirer l’individu X à utiliser l’argument Y ?
- si l’individu X utilise l’argument Y, quels gains pourraient le.la pousser à l’utiliser ?
Selon la réponse que vous apporterez à la question posée, deux cas polaires se présentent :
- vous pensez que l’individu X a intérêt à utiliser l’argument Y. Dans ce cas : il est sans doute préférable de vérifier l’argument Y.
- vous pensez que l’individu X n’a pas intérêt à utiliser l’argument Y. Dans ce cas : il est sans doute moins utile de vérifier l’argument Y. Mais il peut être tout de même utile de le vérifier, pour d’autres raisons.
Comme il s’agit de cas polaires, il est possible d’avoir toutes les nuances possibles entre les deux. Par exemple : “je pense que l’individu X a plutôt intérêt à utiliser l’argument Y, je vais vérifier l’argument Y” ou “je pense que l’individu X n’a pas vraiment intérêt à utiliser l’argument Y, je ne vais pas vérifier l’argument Y”. Et ainsi de suite.
Répondre à ces questions n’est pas la garantie de toujours identifier correctement les incitations. Mais se poser ces questions est déjà une étape importante.
On peut également s’exercer, par exemple en faisant de petites prédictions sur les arguments qui seront utilisés dans un débat à partir des incitations que l’on pense avoir identifié, et regarder si ces prédictions sont vérifiées ou non.
Quelques exemples
- Est-ce qu’un journaliste notoirement opposé aux pesticides a intérêt à présenter des arguments défavorables aux pesticides ? Oui. On vérifie.
- Est-ce qu’un chercheur spécialiste des pesticides a intérêt à présenter des arguments défavorables aux pesticides ? Sans doute pas. On a moins besoin de vérifier.
- Est-ce qu’une figure médiatique qui a construit sa carrière médiatique sur une critique de la science économique a intérêt à continuer à critiquer la science économique ? Oui. On vérifie.
- Est-ce qu’une figure médiatique qui a construit sa carrière médiatique sur une critique de la sociologie a intérêt à continuer à critiquer la sociologie ? Oui. On vérifie.
- Est-ce qu’un médecin homéopathe a intérêt à présenter des arguments favorables à l’homéopathie ? Oui. On vérifie.
- Est-ce qu’un médecin homéopathe a intérêt à présenter des arguments défavorables à l’homéopathie ? Non, et c’est bizarre. Serait-ce une pirouette réthorique ? On vérifie.
- Est-ce qu’un.e militant.e opposé.e à l’avortement a intérêt à présenter des arguments qui montrent l’avortement sous un angle défavorable ? Oui. On vérifie.
- Est-ce qu’un.e militant.e favorable à l’avortement a intérêt à présenter des arguments qui montrent l’avortement sous un angle favorable ? Oui. On vérifie.
Quelques incitations courantes
Pour finir, j’aimerais vous proposer une petite liste d’incitations courantes dans trois contextes : les médias, les réseaux sociaux et la communauté sceptique elle-même. L’idée de cette liste est de vous permettre de gagner du temps en vous évitant d’avoir à réinventer la roue. Cette liste n’est bien évidemment pas exhaustive, seulement indicative, et ne se substitue pas à l’exercice de l’esprit critique !
Voici quelques incitations courantes des personnes prenants la parole dans les médias :
- établir une proéminence symbolique, un prestige
- continuer à se faire inviter pour satisfaire son égo
- entretenir une visibilité pour vendre des livres, se faire inviter à des conférences rémunérées, etc.
- entretenir un réseau de pouvoir et d’influence, notamment auprès des politicien.ne.s et de la haute administration, et influencer les décisions de politique publique
- diffuser des idées que l’on juge importantes
Une part importante de la communauté sceptique vit désormais sur les réseaux sociaux. Les incitations y sont proches de celles des médias, en particulier pour les personnes ayant un nombre important d’abonné.e.s. Il y en a quelques unes en plus, valables quelque soit le nombre d’abonné.e.s :
- montrer aux autres membres de la communauté à laquelle on appartient que l’on en maîtrise les codes, et que l’on est donc un membre légitime de cette communauté
- attaquer des idées et/ou des personnes avec lesquelles on est en désaccord, par exemple pour les faire renoncer à s’exprimer publiquement
Pour finir, j’aimerais aborder quelques incitations courantes chez les sceptiques eux-mêmes. Car les sceptiques ne vivent pas dans un vide social, nous sommes des humains comme les autres et les cadres d’analyse qui s’appliquent aux autres s’appliquent à nous aussi. Voici quelques exemples :
- montrer que l’on est un “bon” sceptique en nommant les sophismes ou biais cognitifs que l’on pense avoir observé dans une discussion
- vouloir “remporter” la discussion à tout prix, pour satisfaire son égo
- attaquer frontalement des personnes avec lesquelles on est en désaccord, car on sait qu’il y a (malheureusement) une partie de la communauté sceptique qui se régale des joutes. Alimenter ces joutes peut être un moyen de gagner une forme de respect et/ou de visibilité.
Il reste un groupe à mon sens important que je n’ai pas abordé dans cette liste d’incitations courantes : les militant.e.s. J’ai souvent constaté des dérives dans les argumentaires sceptiques dès lors que la question du militantisme émerge. Pour cette raison, je veux aborder dans un article dédié ce que les incitations nous disent de ce que nous devons faire des arguments utilisés par les militants. Je publierai cet article la semaine prochaine – et il conclura ce cycle sur les incitations. Si ça n’est pas déjà fait, ne le manquez pas en vous abonnant !
Et c’est ainsi que nous arrivons au terme de ce guide. N’hésitez pas à le partager régulièrement et massivement dans vos réseaux sceptiques – et même ailleurs ! Je suis convaincu que les incitations sont un outil qui peut encore renforcer l’efficacité de la boîte à outils sceptique, et vos partages aideront à faire connaître cet outil dans la communauté. À jeudi prochain pour le dernier volet du cycle sur les incitations !